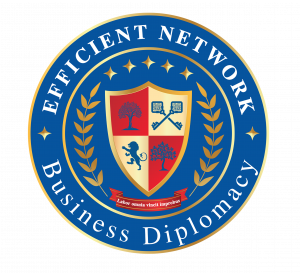L’engagement chinois en Afrique, loin de s’essouffler, se transforme en profondeur. Pour les acteurs africains, cette évolution implique une vigilance stratégique : tirer parti de la réorientation vers l’industrialisation, négocier des partenariats équilibrés, et développer les capacités locales pour éviter les dépendances asymétriques.
Les partenaires occidentaux, quant à eux, doivent intégrer cette nouvelle donne dans leurs stratégies d’influence économique et diplomatique sur le continent. L’Afrique, acteur central de cette triangulation géoéconomique, dispose d’un levier d’action inédit — encore faut-il qu’il soit exploité avec lucidité et vision à long terme.
En 2024, la République populaire de Chine poursuit une reconfiguration stratégique de son engagement économique international, dans un contexte marqué par le ralentissement de sa croissance intérieure, la montée des tensions géopolitiques, et une volonté affirmée de diversification de ses partenariats globaux. L’Afrique, acteur majeur du Sud global, reste au cœur de cette dynamique, avec des évolutions notables dans les secteurs du commerce, de l’investissement, de la finance, de la coopération monétaire et des échanges humains.
Pour les décideurs africains comme pour les acteurs économiques internationaux, comprendre les ressorts de cette nouvelle phase de la présence chinoise est fondamental pour anticiper les trajectoires économiques et les risques/opportunités à moyen terme.
Commerce : Vers une nouvelle structuration des flux
Le commerce bilatéral sino-africain a atteint 282 milliards de dollars en 2023. Ce chiffre, bien que impressionnant, masque des déséquilibres persistants : l’Afrique reste principalement un fournisseur de matières premières, notamment de minerais stratégiques (lithium, cobalt), tandis que la Chine exporte des biens manufacturés à forte valeur ajoutée. La baisse des importations de pétrole africain, au profit de fournisseurs plus stables (Moyen-Orient, Russie), illustre un recentrage chinois sur la sécurité énergétique.
L’émergence de produits agricoles semi-transformés (avocats kényans, viande namibienne) ouvre néanmoins une brèche stratégique dans la composition des exportations africaines. Le développement de plateformes e-commerce sino-africaines comme Kilimall ou JD.com marque aussi une évolution structurelle, rapprochant les marchés et stimulant l’intégration des PME africaines dans les chaînes de valeur.
Investissements : De l’infrastructure à l’industrialisation
Le retrait progressif des investissements publics chinois dans les infrastructures lourdes (routes, barrages, chemins de fer) reflète un réalignement stratégique. Désormais, la priorité est donnée à l’industrialisation locale, portée par le secteur privé chinois. Ce repositionnement, qui
concerne notamment la transformation agro-industrielle et minière, répond à la fois aux besoins des marchés africains (consommation domestique croissante, ZLECAf) et aux contraintes géopolitiques chinoises (sécurisation des chaînes d’approvisionnement critiques).
Cela marque une opportunité pour les pays africains souhaitant monter en gamme dans la chaîne de valeur, à condition de développer un environnement d’affaires compétitif : énergie fiable, infrastructures logistiques, main-d’œuvre qualifiée et politiques industrielles incitatives.
Stabilisation budgétaire : Vers une logique d’accompagnement ciblé
Face à la montée du risque de surendettement en Afrique, la Chine privilégie désormais des approches différenciées de gestion de la dette. L’accord conclu avec la Zambie en 2023 (rééchelonnement plutôt que annulation) traduit une évolution vers une logique de « stabilisation maîtrisée » plutôt qu’un désengagement financier.
Les instruments mobilisés incluent les prêts relais, les fonds de capital-investissement sino-africains, et des partenariats publics-privés ciblés. Ces approches, bien que complexes à mettre en œuvre, permettent de maintenir l’influence économique de Pékin tout en réduisant son exposition directe aux risques souverains africains.
L’internationalisation du RMB est une dynamique opportuniste. L’usage croissant du renminbi (RMB) dans les échanges sino-africains répond à une double logique : diversification des mécanismes de règlement (face aux risques liés au dollar) et offre d’alternatives crédibles aux économies africaines confrontées à une forte volatilité de leur monnaie. Des accords de swap avec les banques centrales africaines, couplés à des initiatives comme le PAPSS, témoignent de cette stratégie. À court terme, l’internationalisation du RMB reste limitée, mais elle peut s’intensifier dans un contexte de reconfiguration monétaire globale et de pressions sur les réserves de change africaines.
Relations humaines : Renforcement du soft power chinois
Sur le plan éducatif et culturel, la Chine renforce activement ses leviers d’influence. En accueillant plus de 80 000 étudiants africains et en multipliant les partenariats universitaires (Confucius Institutes, workshops Luban), Pékin investit dans la formation des élites de demain. La présence croissante de contenus africains sur les plateformes chinoises et la multiplication des accords de facilitation touristique renforcent les liens bilatéraux à l’échelle sociétale. Cependant, les critiques croissantes sur la qualité de l’enseignement, les opportunités professionnelles et l’accueil des étudiants étrangers constituent des axes à surveiller dans l’évaluation de la durabilité de cette stratégie.